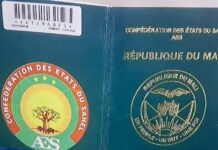Etaticide : Tuer l’Etat.
A l’attention du Groupe Croissance, au monde de l’économie haïtienne et à tous ceux dont la question intéresse !
Aux États-Unis et en Haïti respectivement en avril et en octobre 2024, le Groupe croissance a tenu des symposia pour faire la plaidoirie de l’investissement direct de la Diaspora. Cette façon de voir les choses me taraude l’esprit et je me suis dit de tenter une approche différente dans le souci d’un débat instructif aux jeunes qui le méritent au monde de l’économie haïtienne et à tous ceux dont la question intéresse. Cet article se veut une mise en lumière des défis et des contradictions liés aux investissements directs en Haïti et propose des pistes pour éviter que ces flux financiers ne contribuent à la destruction de l’État. L’implication de la diaspora, combinée à une réforme institutionnelle profonde, est essentielle pour un avenir économique plus stable et inclusif.
L’investissement direct, qu’il soit étranger ou issu de la diaspora, est souvent présenté comme une solution au sous-développement économique d’Haïti. Cependant, en l’absence d’un cadre institutionnel adéquat et d’une gouvernance efficace, ces investissements peuvent paradoxalement affaiblir l’État haïtien, contribuant à une forme d’étaticide – c’est-à-dire à la destruction progressive de l’autorité et de la souveraineté de l’État. La diaspora haïtienne, principal moteur économique du pays à travers les transferts de fonds, est particulièrement vulnérable à cette dynamique, car elle continue de subir les conséquences d’un État défaillant qui ne protège ni ses droits ni ses investissements.
La diaspora haïtienne : un pilier économique négligé et exploité
La diaspora haïtienne joue un rôle central dans l’économie nationale. Selon la Banque mondiale, les envois de fonds des Haïtiens vivant à l’étranger représentent plus de 30 % du PIB du pays, une contribution essentielle à la survie de millions de familles (World Bank, 2021). Pourtant, ces transferts ne bénéficient d’aucun encadrement efficace, et la diaspora continue d’être victime de négligence, de taxation abusive et d’escroqueries organisées, souvent sous le regard passif des autorités.
L’un des cas les plus marquants de cette exploitation fut l’affaire des coopératives financières au début des années 2000, dont Voye Ayiti Monte (VOAM) autour des années 90 fut un exemple emblématique. Ces coopératives avaient promis des rendements élevés aux investisseurs, principalement issus de la diaspora, mais elles se sont avérées être des pyramides de Ponzi qui ont ruiné des milliers de familles. Malgré l’ampleur de la fraude, les autorités haïtiennes n’ont ni poursuivi efficacement les responsables ni mis en place des mécanismes pour éviter que de telles arnaques ne se reproduisent (Dupuy, 2019).
L’investissement direct : Un outil de développement ou un facteur de déstabilisation ?
L’investissement direct, lorsqu’il est bien encadré, peut être un moteur de développement économique. Cependant, en l’absence de régulation stricte et de politiques publiques adaptées, ces investissements peuvent avoir des effets pervers sur la souveraineté économique et politique du pays.
1. Capture de l’économie par des intérêts privés
Dans un contexte de faiblesse institutionnelle, les investisseurs – qu’ils soient étrangers ou membres des élites locales – captent l’essentiel des richesses nationales sans garantir une redistribution équitable. Cette situation empêche la mise en place d’une économie inclusive et renforce les inégalités sociales (Fatton, 2011).
2. Dépendance économique et perte de souveraineté
Lorsque l’État haïtien ne contrôle pas ses secteurs stratégiques (énergie, infrastructures, télécommunications, etc.), il devient vulnérable aux intérêts étrangers. Par exemple, plusieurs contrats signés avec des investisseurs étrangers ne prévoient aucune contrepartie significative pour la population haïtienne, ce qui contribue à l’érosion progressive de la souveraineté nationale (Lundahl, 2013).
3. Déséquilibre fiscal et évasion des capitaux
En Haïti, les grandes entreprises bénéficient souvent d’exemptions fiscales massives, tandis que les contribuables locaux et la diaspora sont soumis à des taxes élevées sans recevoir de services publics en retour. Ce déséquilibre pousse de nombreux Haïtiens à investir ailleurs, privant le pays de capitaux indispensables à son développement (Orozco, 2006).
4. Affaiblissement des initiatives locales
Les initiatives communautaires portées par la diaspora, comme les coopératives d’investissement et les projets de développement rural, sont souvent entravées par un manque de soutien institutionnel. Pire encore, certaines politiques gouvernementales favorisent des investisseurs étrangers qui n’ont aucun intérêt à dynamiser l’économie locale, ce qui nuit aux projets portés par les Haïtiens eux-mêmes (Trouillot, 1990).
Vers un modèle d’investissement équilibré et inclusif
Pour éviter un affaiblissement irréversible de l’État haïtien et transformer les investissements directs en moteur de développement durable, plusieurs réformes sont nécessaires :
• Mise en place d’un cadre légal protecteur pour sécuriser les investissements de la diaspora et éviter les fraudes comme celles des coopératives.
• Encouragement de l’investissement productif en taxant la spéculation financière et en facilitant le financement des projets locaux.
• Renforcement des institutions publiques pour garantir que les investissements profitent réellement au développement du pays et non à une minorité privilégiée.
• Création d’un statut fiscal spécial pour la diaspora, offrant des incitations à ceux qui investissent en Haïti tout en réduisant les taxes injustes sur leurs transferts d’argent.
Conclusion
L’État haïtien, en négligeant sa diaspora et en facilitant des investissements déséquilibrés, s’expose à un affaiblissement progressif qui menace sa propre survie. Si cette tendance persiste, Haïti risque de devenir un pays où l’État n’a plus aucun contrôle sur son économie ni sur son avenir. Il est donc impératif de repenser le rôle des investissements directs en les inscrivant dans une vision de développement national qui bénéficie réellement à l’ensemble de la population.
Yves Lafortune, MAP, Av
PH D Candidate in Public Policy & Administration
Références bibliographiques
• Dupuy, A. (2019). Haiti: From Revolutionary Slaves to Powerless Citizens. Routledge.
• Fatton, R. (2011). Haiti: The Saturnalia of Emancipation. University Press of Florida.
• Lundahl, M. (2013). Poverty in Haiti: Essays on Underdevelopment and Post Disaster Prospects. Palgrave Macmillan.
• Orozco, M. (2006). Understanding the Remittance Economy in Haiti. Inter-American Dialogue.
• Trouillot, M.-R. (1990). Haiti, State Against Nation: The Origins and Legacy of Duvalierism. Monthly Review Press.
• World Bank (2021). Haiti Economic Update. Disponible sur www.worldbank.org.
Diasporaction.fr